Renseignements
>
Mairie de
Saint-Julien-en-Beauchêne
04 92 58 16 45
Office de Tourisme
du Haut-buëch
Aspres/Buëch
04 92 58 68 88
Ressources
>

Visuel jpeg
(cliquer/déplacer)
L'Assomption de
Philippe de Champaigne
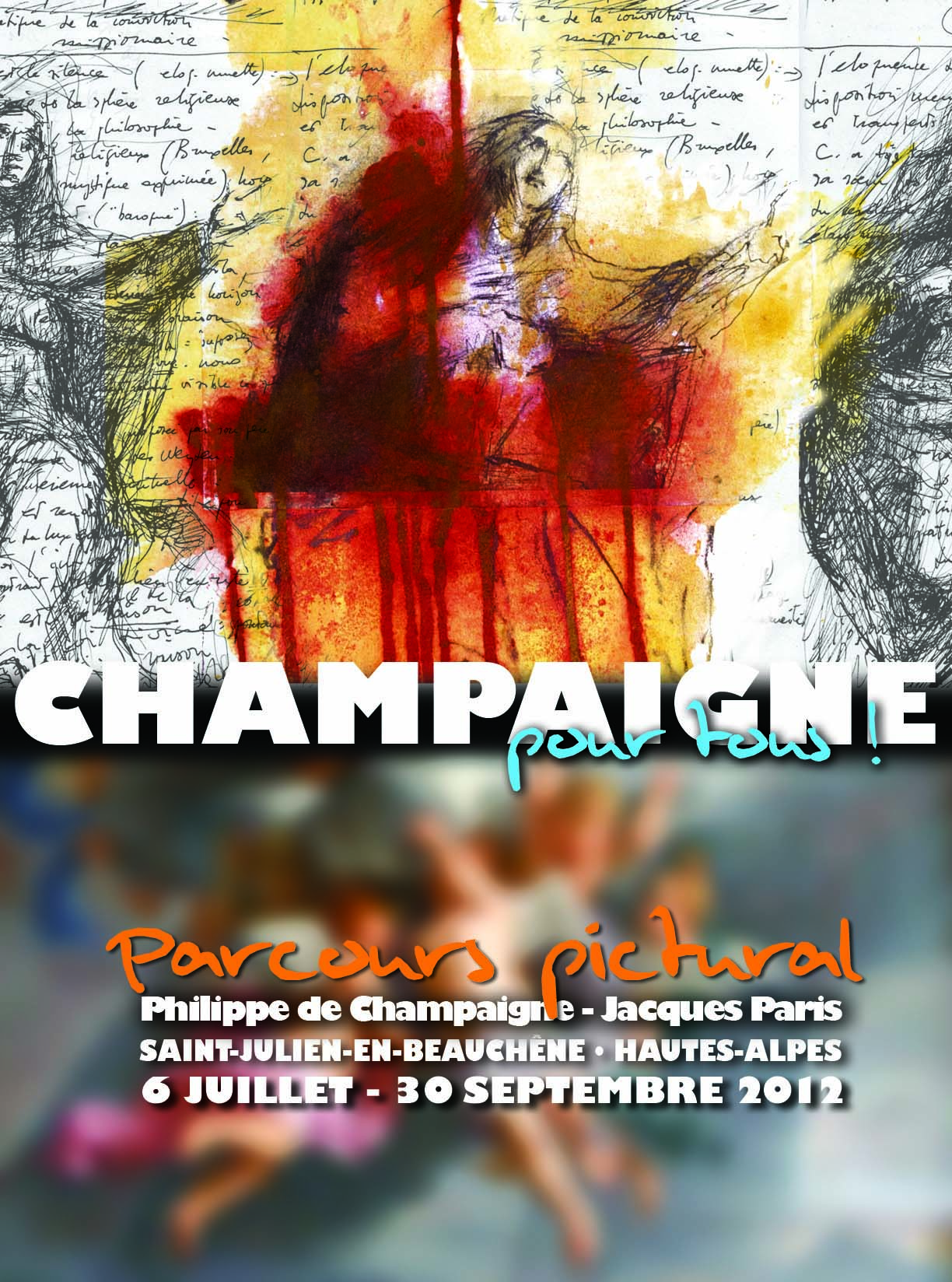
Visuel jpeg
(cliquer/déplacer)
Champaigne pour tous !
l'affiche

PDF
Champaigne pour tous !
Parcours Pictural
Champaign/Paris
le programm
|

Philippe de Champaigne
(1602-1674) -
Elements de biographie
Né en 1602
à Bruxelles, Philippe de Champaigne fait son apprentissage dans
l’atelier bruxellois d’un peintre paysagiste. Comme les artistes
de l’époque, il souhaite visiter Rome, mais s'arrête
à Paris en 1621. Il se fixe au quartier latin où il se
lie d'amitié avec Nicolas Poussin ; en 1625 il commence à
travailler pour son compte. Ayant regagné Bruxelles, il est
rappelé un an plus tard par l’intendant des bâtiments de
Marie de Médicis pour participer à la décoration
du palais du Luxembourg. Commence alors une carrière de peintre
à La Cour : nombreux portraits de Louis XIII, de Marie de
Médicis, du Cardinal de Richelieu : il est le seul peintre
autorisé à peindre le cardinal de Richelieu en habit de
cardinal : il le représente onze fois. Il est, avec Simon Vouet,
l'un des deux peintres les plus recherchés du royaume. Ces
portraits, présents dans tous les livres d’histoire, sont ainsi
plus connus que le peintre lui-même !
Il décore de nombreux bâtiments à Paris : le palais
du cardinal, le dôme de l'église de la Sorbonne ; la
cathédrale Notre-Dame-de-Paris, dont le célèbre
« Vœu de Louis XIII » date de 1638. Il dessine
également plusieurs cartons pour des tapisseries. Il est un des
membres fondateurs de l'Académie Royale de Peinture et de
Sculpture en 1648.
À partir de cette date, il se rapproche des milieux
jansénistes et devient le peintre de Port-Royal. II
exécute une série de portraits des moniales et des
Solitaires qui sont un des sommets de son art. Il est également
très proche des Chartreux dans leur esprit de renoncement et de
pauvreté.
Après 1654, il se heurte à la concurrence de Charles Le
Brun. Il décore l'appartement d'Anne d’Autriche au
Val-de-Grâce ainsi que le réfectoire de cet hôpital.
Il est nommé professeur en 1655 et participe à la
décoration des Tuileries, cette fois sous la direction de
Charles Le Brun.
À la fin de sa vie, son activité pédagogique
devient plus importante : même si aucun écrit ne subsiste
de sa main, il existe des transcriptions de plusieurs de ses
conférences, publiées en 1669. Il y commente plusieurs
œuvres, dont celles du Titien, participant ainsi au débat entre
coloristes et dessinateurs et prônant une attitude
modérée.
Lors d’une, conférence donnée en 1669, Champaigne met en
garde les étudiants contre les risques d’une imitation trop
servile de leurs maitres.
« Toute sa vie il s’est tenu à l’écart de Rubens
que pourtant il n’a jamais cessé d’admirer. » Il insiste
sur l’apprentissage de la diversité : « Raphaël pour
la correction du dessin, Titien pour l’union des couleurs ».
En conclusion du catalogue consacré à l’œuvre de
Philippe de Champaigne, par le Palais des Beaux-arts de Lille,
Alain Tapié note « qu’il n’y a guère de
carrière plus longue que celle de Philippe de Champaigne au
service des souverains qui se succèdent en France de 1625
à 1674 et guère d’artiste plus investi dans la recherche
d’une juste expression du sentiment religieux.
Nourri de multiples expériences et porteur d’un idéal
qu’il tente d’incarner, Champaigne a toujours été reconnu
comme un grand peintre. Il a pratiqué tous les genres, mais
c’est dans la peinture religieuse qu’on saisit le mieux les enjeux de
sa pratique et qu’on peut suivre l’approfondissement de son
esthétique spirituelle »
Extraites du passionnant travail d’Alain Tapié, quelques
phrases très éclairantes sur l’art de Champaigne :
Tapié souligne « son goût de l’ordre et des gestes
à l’arrêt, une réserve et une dignité, une
pudeur, un art sans tapage, un réalisme fondamental, une
intériorité surtout…»
« Il partageait (avec Rubens) une même culture de la
physionomie, de la monumentalité, des drapés, de la
stridence et de la franchise des coloris, de la densité de
l’être dans les postures et les gestes …»
« …dans leur austérité sculpturale, les plis
portent le poids de l’espace, et la couleur l’intensité du temps
présent… »
« La peinture de Philippe de Champaigne tente…par une
gestualité qui semble codée mais qui reste
spontanée, comme suspendue dans l’espace, un coloris dense
qui se déploie avec ampleur dans le vif et le franc, un
agencement structurant des espaces qui rétablit, malgré
la multiplicité des points perspectifs, la
planéité du tableau… »
Claire Lamy
Conservatrice en chef des
bibliothèques
|
Philippe de Champaigne dans son siècle
" Philippe de Champaigne était de tempérament
pieux ; après de nombreux deuils (sa femme, son fils
unique et sa fille cadette), il donne un part encore plus grande
à la religion dans sa vie ; dès 1643 il
fréquente Port-Royal et sa fille Catherine y prend le voile en
1657 : elle figure sur le célèbre tableau l' Ex-Voto en
1662 aux côtés de la Mère Agnès Arnaud. Ce
double portrait est réalisé à la suite d'une
longue maladie invalidante qui affligeait Catherine et qui
guérit miraculeusement. On peut imaginer dans quel
état d'esprit Philippe de Champaigne peignit ce
tableau !
L'Abbaye de Port Royal fut la cible, dès la prise personnelle du
pouvoir de Louis XIV en 1661, de persécutions entre 1709 et
1713 : dispersion des nonnes, destruction des bâtiments de
Port-Royal des Champs, exhumation des corps ensevelis dans
le cimetière ; pourtant nombreuses étaient les
personnalités qui eurent des liens avec Port-Royal à
commencer par Blaise Pascal qui à l'occasion des
polémiques religieuses qui agitèrent ce siècle,
publia les
fameuses Provinciales en 1656 ; on peut citer aussi Jean de La
Fontaine, qui avait noué de solides liens d’amitié avec
Robert Arnaud d’Andilly, poète comme lui. On lui demanda, en
1671, d’apposer son nom prestigieux à une anthologie de
poèmes réunie par les Solitaires dans le cadre de leurs
publications pédagogiques, « le Recueil de
poésies chrétiennes et diverses ».
Dans la période où peu avant sa mort Champaigne peignait
plusieurs Assomptions de la Vierge entre 1970 et 1974, Racine qui avait
fait ses classes aux petites écoles de Port-Royal des Champs
publiait «Bérénice »,
« Bajazet », « Mithridate »
et « Iphigénie », Corneille «Tite et
Bérénice »,
« Psyché » ,
« Pulchérie » et
« Suréna » ; Molière :
« Le Bourgeois Gentilhomme » en 1670 avec une
musique de Lully ; et « Le Malade
Imaginaire » en 1673 avec une musique de
Charpentier ; Boileau, « L'Art Poétique » en
1674 et Bossuet avait déjà prononcé deux oraisons
funèbres. "
Elsa Micholet
|
|
|
|

